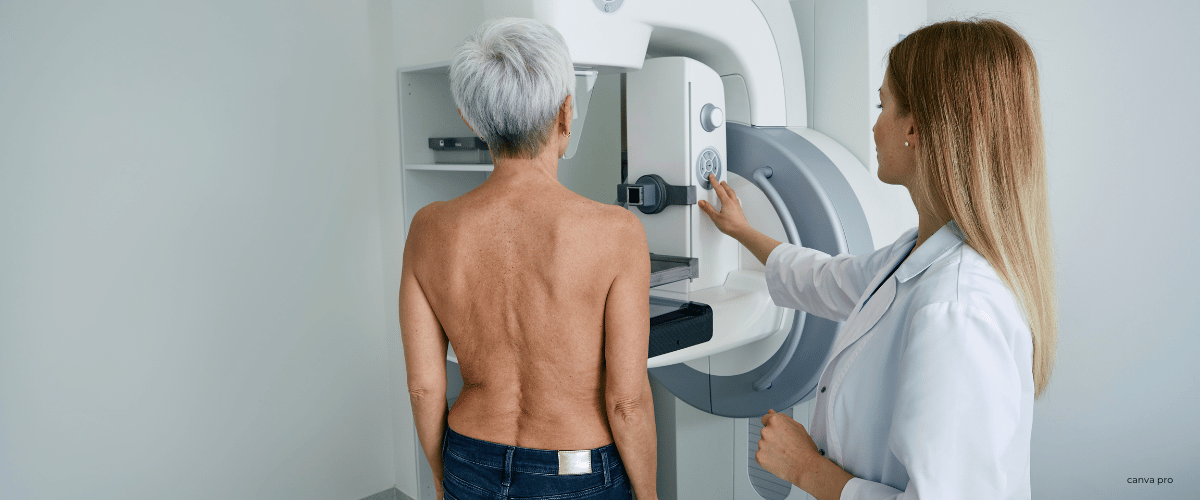Cancer du sein : quand la mammographie est un privilège de territoire
Chaque année, « Octobre Rose » revient avec ses campagnes, son ruban rose et son message : “Le dépistage du cancer du sein sauve des vies.” Cependant, derrière la sensibilisation médiatique, une réalité persiste… Dans de nombreux territoires, l’absence de radiologues, la fermeture progressive des cabinets et l’explosion des délais de rendez-vous transforment le dépistage en un véritable défi pour les femmes. La mammographie devient alors un privilège réservé à certaines zones géographiques.
Et si, cette année, nous profitions d’Octobre Rose pour regarder au-delà des campagnes de sensibilisation ? Quel est l’état de l’accès à la radiologie dans les zones rurales et périurbaines souvent qualifiées de déserts médicaux ?
Dépistage du cancer du sein : une participation trop faible et inégalitaire
En France, moins de la moitié des femmes âgées de 50 à 74 ans prennent part au programme national de dépistage du cancer du sein. Pourtant, le dépistage est essentiel pour détecter une tumeur à un stade précoce.
Ainsi, d’après une étude de Santé publique France, environ 2 620 500 femmes ont réalisé une mammographie de dépistage organisé en 2023, soit un taux national de participation de 48,2 % (contre 44,8 % en 2022). Malgré une légère augmentation, cela reste insuffisant. Ce taux est bien en dessous des 70 % recommandés par l’Union Européenne.
Il existe de fortes disparités géographiques. La Bourgogne-Franche-Comté, la Normandie, la Bretagne ou encore l’Auvergne-Rhône-Alpes enregistrent les meilleurs taux de participation, autour de 54 %. Globalement, ces régions présentent une densité correcte de centres spécialisés, une culture locale de prévention bien ancrée, une moindre pression démographique et un accès facilité aux rendez-vous.
À l’inverse, la Guyane affiche un taux exceptionnellement bas (entre 15 et 21 %), la Corse, la Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Île-de-France (zones périurbaines) figurent parmi les plus faibles. Ces territoires partagent plusieurs difficultés :
- Problèmes d’accès : déserts médicaux, peu de cabinets, difficultés pour obtenir des rendez-vous
- Contraintes structurelles : zones rurales ou ultramarines avec des infrastructures de santé limitées, campagnes d’information moins intenses
- Pression urbaine : dans les grandes agglomérations, la participation est plus faible, même au cœur de zones pourtant bien couvertes
Dans plusieurs zones rurales et périurbaines, il faut attendre des semaines pour un rendez-vous. Les délais pour un examen de radiologie peuvent dépasser les 30 jours, seuil fixé comme limite acceptable.
>>> Lire l’article : Cancer du sein, les soins de support pour le mieux être
Les déserts radiologiques : symptôme d’un système à bout de souffle
L’imagerie médicale est essentielle pour détecter, diagnostiquer et traiter de nombreuses pathologies. Cependant, la radiologie est aussi victime d’un système de santé défaillant.
Selon la Fédération nationale des médecins radiologues (FNMR), environ 15 % des centres de radiologie libéraux ont fermé leurs portes au cours des dix dernières années. Depuis 2020, une accélération des fermetures est constatée. Cette tendance touche en particulier les zones rurales et périurbaines, où les départs à la retraite des praticiens ne sont pas compensés. Les radiologues primo accédants ne s’installent plus seuls. Les cabinets se regroupent et disparaissent dans les petites villes.
La réduction du nombre de centres agréés avec double lecture pour la mammographie est également préoccupante. Par exemple, dans le Vaucluse, on est passé de 27 centres en 2002 à seulement 9 en 2024, une baisse de près de 70 %, qui pénalise directement les campagnes de dépistage organisé du cancer du sein. Ces fermetures s’inscrivent dans un contexte de concentration des plateaux techniques dans les grandes agglomérations.

Radiologues : une profession vieillissante, concentrée, absente des campagnes
D’après le Conseil national de l’Ordre des médecins, environ 12 800 radiologues étaient en exercice en 2024. Plus de 41 % d’entre eux ont plus de 60 ans, et les départs à la retraite s’accélèrent. Une large part partira d’ici 5 à 10 ans. Certaines zones du territoire se retrouvent largement sous-dotées, avec à peine 2 à 3 radiologues pour 100 000 habitants, bien en dessous de la moyenne nationale (environ 11). À titre d’exemple, la Provence-Alpes-Côte d’Azur compte jusqu’à 17 radiologues pour 100 000 habitants.
Comme d’autres spécialités, la radiologie fait face au défi du renouvellement. Les zones rurales n’arrivent pas à attirer de jeunes radiologues : difficultés de recrutement, lourdeur des charges, manque d’attractivité, déremboursement des actes par la sécurité sociale sont autant de freins à l’installation.
Derrière cette pénurie, c’est tout un déséquilibre structurel qui s’exprime :
- La formation des radiologues est longue, et leur installation concentrée dans les centres urbains avec accès à un plateau technique d’imagerie en coupes réglementé par l’ARS.
- Les jeunes praticiens hésitent à s’installer dans les zones rurales, faute de réseau professionnel. Les seniors y exercent encore de manière isolée, sans accès à l’imagerie de coupe ni aux gestes interventionnels enseignés dans le nouveau cursus. Ils doivent également déposer des dossiers administratifs lourds à l’ARS pour obtenir une autorisation d’installation d’IRM et de scanner, et ne peuvent pas toujours participer aux réunions multidisciplinaires sur les cas cliniques complexes et les prises en charge thérapeutiques. Enfin, le manque d’adressage local complique l’accès aux traitements.
- Le système de tarification à l’acte pousse à la rentabilité maximale en milieu dense, au détriment de la présence territoriale
Moins de radios, plus de retards, plus de risques
Les déserts médicaux retardent l’accès aux soins et aux dépistages. L’accès à la mammographie ne devrait pas dépendre du code postal. Pourtant, la France affiche une fracture sanitaire.
Selon l’UFC-Que Choisir, 23,6 % des femmes vivent dans un désert gynécologique, ce qui renforce la probabilité d’un désert radiologique associé. Moins de la moitié des femmes éligibles au dépistage sont dépistées, avec d’importantes disparités territoriales.
Mammobiles : une réponse mobile… mais pas une solution miracle
Depuis quelques années, les mammobiles sillonnent les routes des territoires sous-dotés. Ces camions équipés d’un mammographe rapprochent l’examen des patientes. Ils représentent une alternative pour maintenir une offre minimale de prévention. Cependant, ces dispositifs ont des limites. En effet, leur passage reste ponctuel, parfois une ou deux fois par an. Ils ne permettent pas une seconde lecture immédiate, allongeant les délais en cas de suspicion.
Le problème est déplacé alors dans la prise ne charge des patientes a qui les mammobiles ont dépisté un cancer : à qui les adresser ? quel est le délai de prise en charge ? Dans les mammobiles, la comparaison et l’antériorité des mammographies des patientes ne sont pas disponibles, alors que l’évolutivité est un facteur essentiel au dépistage…
De plus, leur financement repose souvent sur les collectivités ou les associations, rendant leur déploiement inégal.
Les mammobiles sont un outil de rattrapage, mais pas une solution structurelle. Ils ne peuvent remplacer une offre de radiologie fixe, pérenne et efficace.
Quelles solutions pour un dépistage vraiment accessible ?
Pour contrer les inégalités d’accès à la radiologie, nous pouvons citer plusieurs leviers d’actions :
- Encourager l’installation des radiologues dans les zones sous-dotées via des aides financières, des exonérations fiscales ou des incitations territoriales
- Sensibiliser les internes aux opportunités de carrières hors des grandes villes
- S’appuyer sur la téléradiologie et les centres de lecture mutualisés pour permettre la relecture à distance des mammographies, entre autres, ils pallient le manque local de spécialistes tout en garantissant la qualité du diagnostic.
- Adapter les campagnes d’Octobre Rose aux réalités territoriales. Dans les zones rurales ou à faible accessibilité, développer des actions ciblées, ancrées localement, pour informer, rassurer, et mobiliser les patientes
Profitons d’Octobre Rose pour ne pas nous contenter de sensibiliser, mais pour réclamer un véritable accès à la radiologie pour toutes et pour tous.