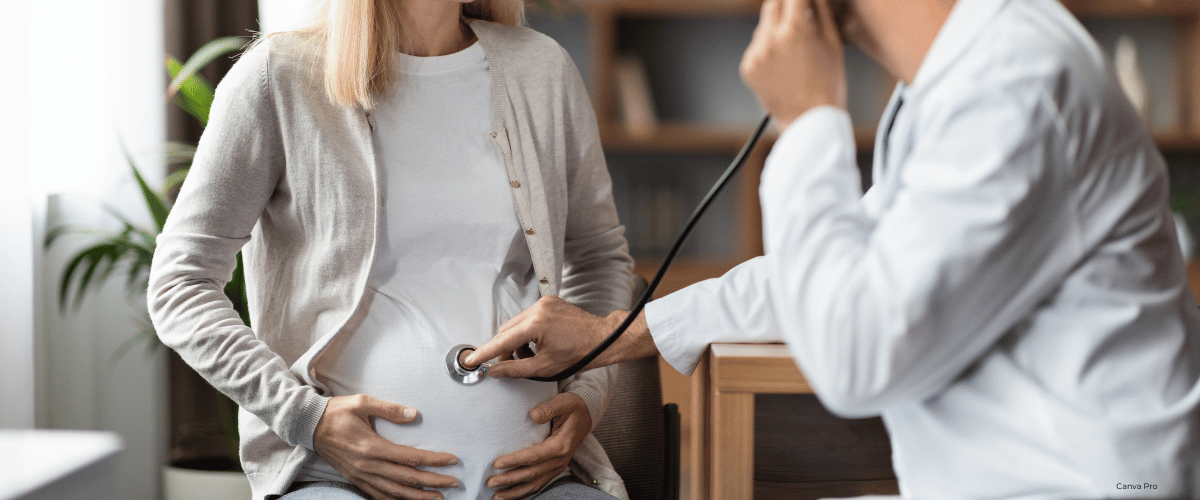Homme Sage-Femme : une nouvelle vision du métier qui bouscule les stéréotypes
Quand on pense au métier de sage-femme, naturellement, l’image d’une femme s’impose. Et pourtant, des hommes exercent aussi cette profession, encore méconnue dans sa version masculine. Minoritaires mais bien présents, les sages-femmes hommes interrogent. Ils étonnent parfois et participent à redéfinir les contours d’un métier vieux comme le monde. Acceptation, visibilité, reconnaissance : leur présence soulève des enjeux sociaux. Découvrons la réalité de ces hommes qui accompagnent les femmes dans chaque étape marquante de leur vie.
Être Sage-femme homme : une vocation avant tout
Devenir sage-femme n’est pas un choix anodin. C’est un engagement, une vocation. Le métier de sage-femme demande cinq années d’études rigoureuses et des qualités humaines : empathie, patience, écoute et sang-froid. Les sages-femmes accompagnent la vie à chaque étape clé : surveillance de la grossesse, accouchement, suivi postnatal, soins au nouveau-né… Cependant, leur rôle ne résumé pas qu’à cela. Les sages-femmes conseillent en matière de contraception, suivent la santé gynécologique de prévention et accompagnent les femmes lors de la ménopause.
Longtemps, ce métier a été intimement lié à la féminité. L’idée persistait que seules des femmes pouvaient comprendre toutes les subtilités physiques et émotionnelles de la maternité. Pourtant, les temps changent. Depuis quelques années, des hommes franchissent cette barrière symbolique. En 2022, selon les données du ministère de la Santé, environ 2 % des sages-femmes en France étaient des hommes. Peu nombreux, certes, mais leur présence symbolise une ouverture précieuse pour la profession et pour la société.
Alors, pourquoi devenir sage-femme quand on est un homme ? Par passion, tout simplement. Une envie profonde d’accompagner les femmes et les familles dans l’un des moments les plus forts de leur existence. Sur le terrain, ces professionnels sont souvent salués pour leur calme, leur capacité d’écoute et leur grand professionnalisme. Côté formation, il n’y a aucune différence. Après une première année de santé (PASS ou L.AS), tous suivent quatre années intenses d’études de maïeutique, ponctuées de stages en maternités et hôpitaux. À l’issue de ce parcours, ils obtiennent le diplôme d’État de sage-femme.
>>> Lire l’article : Le 5 mai, journée internationale de la Sage-Femme
Acceptation et visibilité : un chemin semé d’embûches pour les hommes sages-femmes
L’intégration des hommes dans la profession de sage-femme reste aujourd’hui un véritable défi. En effet, les représentations traditionnelles sont profondément ancrées. En France, la maternité est encore perçue comme une expérience exclusivement féminine. La figure de la sage-femme femme est une évidence naturelle. Dans cet imaginaire collectif, l’idée qu’un homme puisse accompagner une femme enceinte soulève parfois des incompréhensions, voire des réticences.
Les stéréotypes de genre, toujours bien présents, compliquent cette reconnaissance. Certains patients — et parfois même des collègues — peuvent hésiter à accorder leur confiance à un homme. La préférence pour une sage-femme féminine est souvent justifiée par le sentiment qu’une femme « comprendra mieux » les bouleversements physiques et émotionnels liés à la maternité. Cette préférence, bien que compréhensible sur le plan émotionnel, peut renforcer l’invisibilité des hommes dans cette profession.
Sur le terrain, les hommes sages-femmes doivent souvent faire face à une forme de discrimination silencieuse. Remarques déplacées, doutes sur leurs compétences, étonnement persistant face à leur choix de carrière… Autant d’obstacles quotidiens qui témoignent d’une difficulté à sortir des schémas traditionnels. D’ailleurs, selon une étude menée par l’Ordre des sages-femmes, plus de 60 % des sages-femmes hommes interrogés disent avoir été confrontés à des attitudes de méfiance ou à des stéréotypes liés à leur genre.
Pourtant, leur présence est précieuse. Petit à petit, les mentalités évoluent. La visibilité croissante des hommes dans les écoles de maïeutique, dans les hôpitaux et en libéral contribue à déconstruire les tabous. Leur compétence, leur écoute et leur engagement démontrent que la qualité des soins dépend avant tout des qualités humaines et professionnelles, bien au-delà des questions de genre.
Briser ces stéréotypes demande du temps, de l’éducation et beaucoup de pédagogie. Ainsi, chaque homme sage-femme qui exerce aujourd’hui ouvre un peu plus la voie vers une profession plus ouverte et diverse.
Homme Sage-femme au sein de l’équipe médicale
Malgré les défis auxquels ils peuvent être confrontés, les sages-femmes hommes exercent exactement les mêmes missions que leurs collègues féminines. Leur rôle est au cœur de l’accompagnement de la maternité : assurer le suivi médical des femmes enceintes, surveiller l’évolution de la grossesse, prendre en charge les accouchements, prodiguer les premiers soins au nouveau-né, et soutenir les jeunes parents dans les premiers pas de leur parentalité.
Ils interviennent aussi dans la prévention et l’éducation à la santé : sensibilisation à la contraception, accompagnement des femmes en préménopause, conseils autour de la grossesse et de la naissance, mais aussi éducation aux soins du nourrisson. Ce rôle éducatif est fondamental pour préparer les futurs parents aux réalités de l’accueil d’un enfant.
Lors d’un accouchement, qu’ils soient hommes ou femmes, les sages-femmes sont responsables de la surveillance du bien-être de la mère et du bébé. Ils gèrent les contractions, assistent et conseillent sur les postures d’accouchement, et veillent au bon déroulement de la naissance. Une fois l’enfant venu au monde, ils réalisent l’examen clinique, prodiguent les premiers soins (pesée, premiers bains, premiers gestes de soins) et assurent un suivi rapproché de l’état de santé physique et psychologique de la mère.
Le soutien émotionnel constitue également une dimension essentielle du métier. Être à l’écoute des inquiétudes, accompagner les premiers doutes, et orienter les jeunes mères vers des aides adaptées si besoin. Beaucoup de sages-femmes hommes sont également formés à la rééducation périnéale, à l’accompagnement de l’allaitement et à la prévention des risques liés à la grossesse et au post-partum.
En transmettant des connaissances, en rassurant et en favorisant un début de parentalité serein, les hommes sages-femmes jouent un véritable rôle d’éducateur et de repère pour les familles
Les chiffres clés : une profession en évolution
En 2021, selon l’Ordre des sages-femmes, on comptait environ 23 000 sages-femmes en exercice en France, dont seulement 2 % étaient des hommes — soit près de 460 professionnels. Un chiffre encore modeste mais qui témoigne d’une évolution progressive vers plus de diversité dans ce métier historiquement féminin.
Les hommes sages-femmes sont majoritairement concentrés dans les grandes agglomérations et les centres hospitaliers universitaires (CHU), là où les opportunités de formation, de spécialisation et d’emploi sont plus accessibles. On les retrouve également de plus en plus dans les domaines de la recherche et de l’enseignement, où leur présence est souvent perçue comme un signe d’ouverture et de modernisation des pratiques.
Par ailleurs, certains établissements de santé, notamment ceux qui mènent des politiques actives de diversité et d’inclusion, reconnaissent pleinement l’apport des hommes au sein des équipes de sages-femmes. Ces structures prennent parfois des initiatives concrètes pour faciliter leur intégration dans un environnement encore très majoritairement féminin : dispositifs d’accompagnement, sensibilisation des équipes, valorisation de la mixité dans les services de maternité…
Même si le chemin vers une véritable parité est encore long, chaque nouvelle promotion d’hommes sages-femmes contribue à faire évoluer les mentalités. Leur présence enrichit la profession et incarne une vision plus ouverte, plus représentative de la société actuelle.
>>> Lire article : Endométriose, affiches de sensibilisation